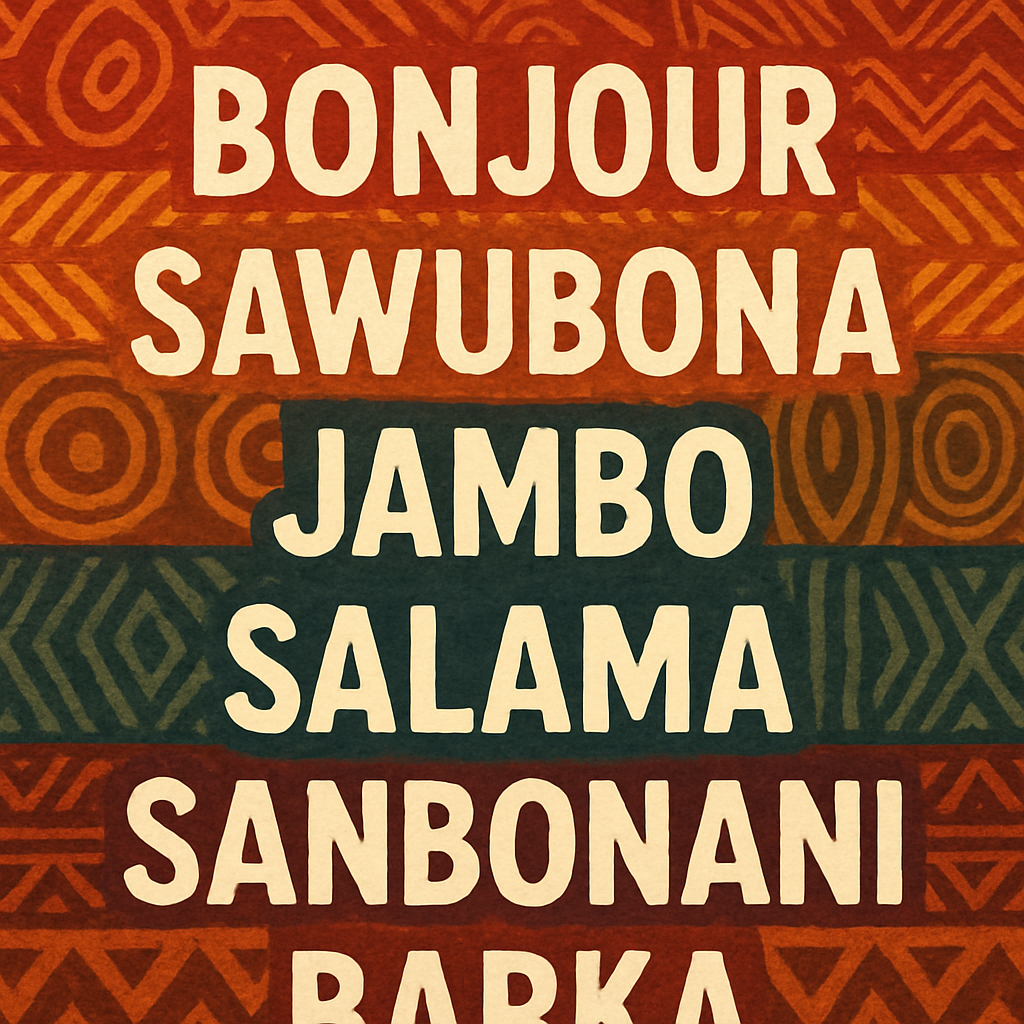« Enseigner dans la langue maternelle, c'est comme planter une graine dans un sol fertile ; l'apprentissage s'enracine plus profondément et grandit plus vite », déclare Fatou, enseignante de l'école primaire à Koudougou (interview, septembre 2025). En Afrique, les systèmes éducatifs soulèvent de plus en plus de préoccupations. Bien qu’ils visent à former les générations futures, ils restent largement structurés autour de langues coloniales comme le français, l’anglais ou le portugais. De plus en plus de pays et de communautés plaident pour l'intégration et l'utilisation des langues africaines comme véhicules d'enseignement dès le plus bas âge. Cette approche, soutenue par des études pédagogiques, promet un meilleur taux d'alphabétisation et une appropriation des savoirs. Cela permet de promouvoir les langues maternelles, véhicule de la culture.L’école africaine ne pourra jamais remplir sa mission tant qu’elle continuera à ignorer les langues et les cultures locales. Enseigner dans une langue étrangère, c’est enseigner à distance, Pr. Joseph Ki-Zerbo.
Selon l'UNESCO (2024), les élèves qui commencent leur scolarité dans leur langue maternelle ont 25 % de chances en plus de réussir leur scolarité primaire. Cette dynamique montre qu'une véritable révolution pédagogique est en marche, visant à ancrer l'éducation dans les réalités locales.
L'école primaire comme fondation de la bi-alphabétisation
L'intégration des langues locales dès le cycle primaire est important pour faciliter la transition vers les concepts que les apprenants n'arrivent pas à s'approprier. Les enfants développent leur pensée critique plus facilement lorsqu'ils opèrent dans une langue qu'ils maîtrisent pleinement. Les leçons sont mieux comprises dans les langues maternelles.
Exemple : Au Togo, le projet pilote Édu-Langues a introduit l'enseignement des mathématiques et des sciences en Éwé et en Kabyè dans 50 écoles. Les résultats ont montré une augmentation de 20 % des notes moyennes dans ces matières par rapport aux écoles enseignant uniquement en français (Ministère de l'Éducation Primaire, Togo, 2024). « Quand ma maîtresse m'explique les chiffres en Éwé, je comprends tout de suite. Le français, je l'apprends mieux après » (Mariam 9 ans, élève à Lomé interview, septembre 2025).
Dans plusieurs pays africains, la phase d’expérimentation de l’enseignement en langues locales est désormais dépassée. Des États comme l’Afrique du Sud ont institutionnalisé l’usage des langues africaines dès le cycle primaire, avec des résultats mesurables. Depuis 1996, la Constitution sud-africaine reconnaît onze langues officielles, dont neuf africaines. En 2022, plus de 80 % des élèves du primaire ont reçu un enseignement primaire dans leur langue maternelle, comme le IsiZulu, IsiXhosa et Sesotho (Department of Basic Education).
Pour certains chercheurs, ces réformes sont d'une grande nécessité car l’usage des langues africaines à l’école n’est pas une concession identitaire, mais une condition de réussite scolaire. L’enfant qui apprend dans sa première langue développe plus tôt ses capacités de raisonnement et de compréhension.
L'université : un terrain fertile pour la production de savoirs locaux
L'enjeu de l'enseignement en langues africaines n'est pas qu'une affaire de l'enseignement primaire. L'université devient le lieu où les étudiants peuvent non seulement étudier, mais aussi produire des recherches et des contenus scientifiques directement dans leurs langues.
Selon Pierre Baligue Diouf, linguiste et spécialiste des politiques éducatives et de l'intégration des langues nationales,« L’intégration des langues africaines dans l’enseignement supérieur n’est pas une utopie, mais une nécessité pour que les savoirs produits soient en phase avec les réalités sociales et culturelles des apprenants ».
Au Sénégal, depuis 2018, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a lancé un programme pilote permettant à des étudiants en philosophie ou de linguistique de rédiger leurs mémoires en Wolof, avec l’appui du Ministère de l’Enseignement Supérieur du Sénégal, ce qui a permit la soutenance de hit mémoires entre 2018 et 2022. Selon Moussa (étudiant en sociologie) : « Rédiger une analyse philosophique en Wolof m'a permis d'exprimer des nuances et des idées qui étaient bloquées lorsque j'essayais de les forcer dans le moule du français » (interview, septembre 2025).
Selon l'Association des Universités Africaines (2023), l'utilisation des langues locales dans la recherche universitaire augmente la pertinence des études pour les communautés de 50 %, en facilitant le transfert de connaissances. Quand un étudiant rédige en Wolof, en Mooré ou en Swahili, il pense avec ses propres repères culturels. Cela rend ses idées plus claires, plus profondes, et plus proches de la réalité locale. C’est aussi une façon de rendre la science plus accessible et de valoriser les langues africaines comme langues de savoir.
L'impact sur la dignité culturelle et l'identité scientifique
Utiliser les langues africaines dans l'enseignement n'est pas seulement une question de pédagogie ; c'est un acte de valorisation de la culture et un pas vers la décolonisation du savoir. Cela donne aux jeunes la conviction que leurs langues sont capables de véhiculer n'importe quelle idée, scientifique ou philosophique. Selon Valentin-Yves Mudimbe «La langue est le lieu de l’identité, de la mémoire et de la dignité. Refuser aux langues africaines leur place dans la production du savoir, c’est refuser aux peuples africains le droit de penser par eux-mêmes.»
Exemple : Au Nigeria, une initiative privée a mené à la traduction de manuels de physique avancée en haoussa et en yoruba. Ce projet a permis de former des instructeurs techniques capables de transmettre des compétences de pointe directement aux artisans locaux (Foundation for Indigenous Knowledge, Nigeria, 2024). Selon Kemi, 22 ans, traductrice et ingénieure, pouvoir expliquer des équations complexes dans ma langue maternelle, c'est une fierté. Cela me donne la confiance nécessaire pour innover sans attendre la permission de l'extérieur » (interview, septembre 2025).
L'Organisation Internationale de la Francophonie (2023) note que l'intégration des langues nationales ne mène pas à un déclin des langues officielles, mais plutôt à un bilinguisme équilibré qui renforce les capacitéscognitives des apprenants.
Conclusion
L’intégration des langues africaines dans l’enseignement représente une avancée majeure vers une éducation plus équitable, enracinée et efficace. Parler, interviewer, chercher, améliorer ses compétences, se développer c'est possible dans les langues maternelles africaines. En les valorisant, on favorise non seulement la réussite scolaire, mais aussi la reconnaissance des identités culturelles et des savoirs endogènes, africains.
Références
-
- UNESCO (2023). _Enseignement bi-plurilingue et inclusion éducative_. [https://ifef.francophonie.org/elan](https://ifef.francophonie.org/elan)
- Diouf, P. B. (2019). _Innovations pédagogiques au Sénégal_. [https://hal.science/hal-03640374/document](https://hal.science/hal-03640374/document)
- UNESCO (2010). _Guide de politique sur l’intégration des langues africaines dans l’éducation_, Ouagadougou.
- Ki-Zerbo, Joseph, Éduquer ou périr, Paris: Éditions Karthala, 1990.
- Ki-Zerbo, Joseph, À quand l’Afrique?, Paris: Éditions de l’Aube, 2003.
- https://theconversation.com/valentin-yves-mudimbe-le-penseur-qui-a-theorise-la-decolonisation-des-savoirs-africains-255397