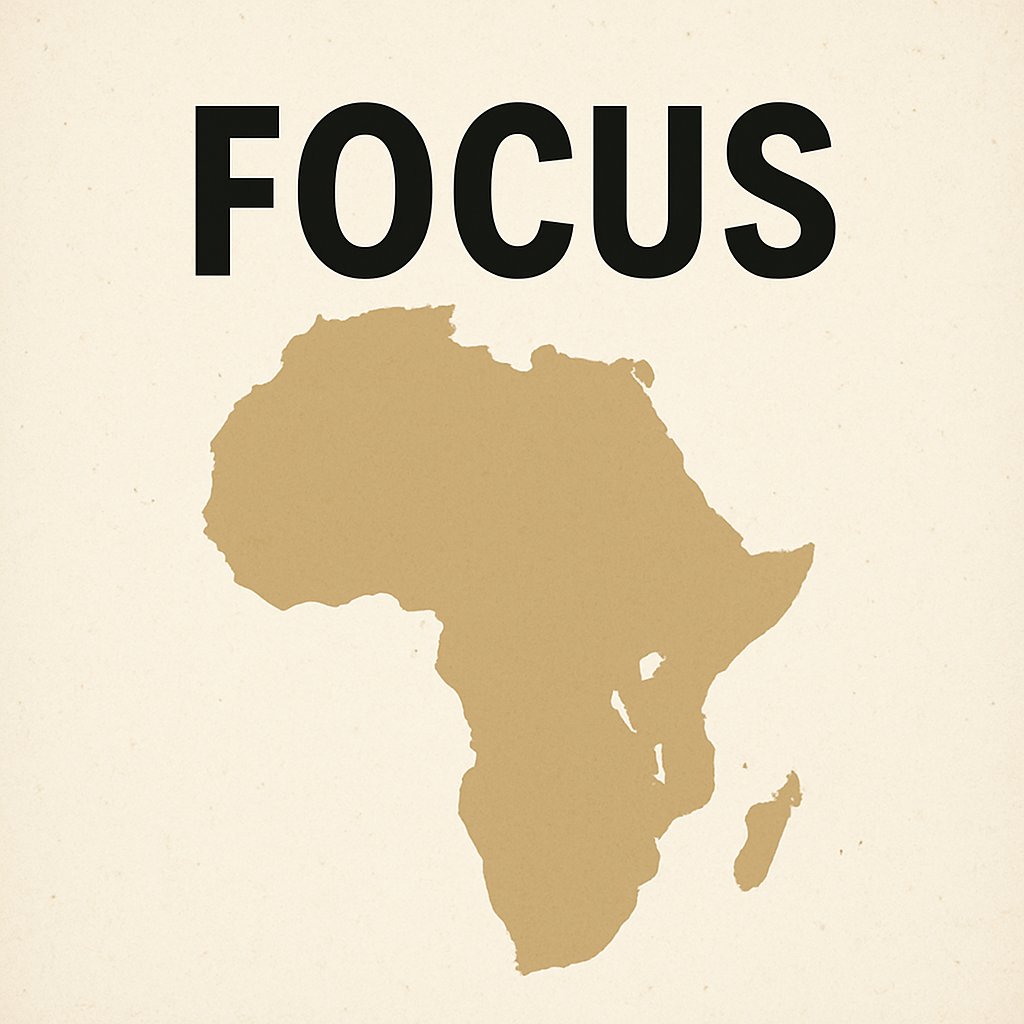Depuis plusieurs décennies, plusieurs chercheurs africains se sont emparés des questions décoloniales, impulsant les mouvements de décolonisation des savoirs à travers le monde. Des figures comme Achille Mbembe, Valentin-Yves Mudimbe ou encore Paulin Hountondji ont ouvert des brèches épistémologiques majeures, remettant en question les paradigmes occidentaux qui structurent notre compréhension du continent africain. Toutefois, on constate que certains concepts demeurent difficiles à décoloniser, englués dans des représentations héritées de l'époque coloniale. C'est particulièrement le cas du concept de pauvreté.
Qu'est-ce que la pauvreté? Comment regarde-t-on la pauvreté? Ces questions, apparemment simples, révèlent en réalité des tensions épistémologiques profondes. Doit-on observer la pauvreté du point de vue des institutions internationales, particulièrement la Banque mondiale qui a largement imposé le seuil de 2,15 dollars par jour comme mesure universelle? Ou doit-on regarder la pauvreté du point de vue des populations et communautés africaines elles-mêmes, avec leurs propres conceptions du bien-être, de la dignité et de la prospérité?
Comme le souligne Arturo Escobar dans son ouvrage fondateur Encountering Development, "la pauvreté à grande échelle dans le monde moderne est apparue après la Seconde Guerre mondiale, non pas parce que les gens étaient devenus plus pauvres, mais parce qu'un nouveau regard sur la vie sociale avait été créé". Cette observation résonne particulièrement en Afrique, où les populations ont été soudainement catégorisées comme "pauvres" selon des critères exogènes, effaçant des millénaires de systèmes économiques et sociaux alternatifs.
Cet article propose une réflexion critique sur la nécessité de décoloniser le concept de pauvreté en Afrique. Il s'agit d'interroger les fondements historiques et idéologiques de ce concept, de déconstruire les mécanismes de production du savoir sur la pauvreté africaine, et de proposer des pistes pour une nouvelle épistémologie qui recentre les perspectives africaines. Cette démarche est particulièrement cruciale pour les jeunes chercheurs africains qui souhaitent travailler sur ces questions sans reproduire les schémas colonialistes.
Partie 1: Petite histoire de la pauvreté
L'invention de la pauvreté comme catégorie globale
L'histoire de la pauvreté comme concept global est intimement liée à l'histoire du développement économique occidental. Avant le XIXe siècle, la pauvreté était comprise de manière locale et contextuelle, intégrée dans des systèmes de solidarité communautaire et religieuse. Majid Rahnema, dans son article "Poverty" du Development Dictionary, explique que "dans la plupart des langues vernaculaires, il n'existait pas de mot équivalent à la notion moderne de pauvreté économique".
C'est avec l'expansion coloniale européenne que la pauvreté devient un outil de catégorisation et de hiérarchisation des sociétés. Les puissances coloniales ont utilisé le prisme de la "pauvreté" pour justifier leur mission civilisatrice. L'Afrique, en particulier, a été représentée comme un continent plongé dans l'obscurité et le dénuement, nécessitant l'intervention salvatrice de l'Occident. Cette représentation a été systématisée dans les écrits de voyageurs, missionnaires et administrateurs coloniaux du XIXe siècle.
L'ère du développement et la standardisation de la pauvreté
Le véritable tournant survient après la Seconde Guerre mondiale avec l'émergence du paradigme du développement. Le discours d'investiture du président américain Harry Truman en 1949 est souvent cité comme moment fondateur. Truman déclare que "plus de la moitié de la population mondiale vit dans des conditions proches de la misère" et appelle à un "programme audacieux" pour le développement des régions "sous-développées". Comme l'analyse Gilbert Rist dans Le développement: histoire d'une croyance occidentale, ce discours crée une nouvelle cartographie mondiale divisée entre pays "développés" et "sous-développés", catégorisant instantanément des milliards de personnes comme "pauvres".
Les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale créée en 1944, vont progressivement institutionnaliser une définition monétaire et quantitative de la pauvreté. Dans les années 1990, la Banque mondiale établit le célèbre seuil de pauvreté à un dollar par jour (ajusté depuis à 2,15 dollars), créant ainsi une mesure prétendument universelle et objective. Cette standardisation efface toute considération culturelle, sociale ou historique des conditions de vie des populations.
La pauvreté en Afrique: un récit construit
En Afrique, cette construction de la pauvreté a eu des effets particulièrement pernicieux. Le continent a été transformé en symbole même de la pauvreté mondiale, alimentant ce que Wangui wa Goro appelle "l'afro-pessimisme". Les médias internationaux, les campagnes humanitaires et même la recherche académique ont contribué à créer une image monolithique de l'Afrique comme continent de la misère, de la famine et du désespoir.
Cette représentation ignore délibérément plusieurs réalités historiques fondamentales. Premièrement, les systèmes économiques précoloniaux africains étaient diversifiés et souvent prospères, comme l'ont démontré les travaux de Catherine Coquery-Vidrovitch et de Walter Rodney. Deuxièmement, l'appauvrissement de nombreuses régions africaines est directement lié aux politiques coloniales d'extraction des ressources, de travail forcé et de destruction des économies locales. Comme l'affirme Rodney dans How Europe Underdeveloped Africa, "l'Afrique a contribué au développement capitaliste de l'Europe occidentale, au prix de son propre sous-développement".
Troisièmement, les politiques post-indépendance imposées par les institutions financières internationales, notamment les programmes d'ajustement structurel des années 1980-1990, ont aggravé la situation en démantelant les services publics et en libéralisant les économies africaines selon les prescriptions néolibérales. Samir Amin parlait à ce propos de "paupérisation planifiée".
Partie 2: Déconstruire le concept de pauvreté en Afrique
Les limites des approches quantitatives
La domination des mesures monétaires de la pauvreté pose plusieurs problèmes épistémologiques majeurs. En réduisant la pauvreté à un revenu journalier, on opère une simplification brutale qui efface la complexité des vies humaines. Comme le note Amartya Sen, prix Nobel d'économie, dans Development as Freedom, la pauvreté devrait plutôt être comprise comme un manque de "capabilités" c'est-à-dire la liberté de réaliser des fonctionnements qu'une personne a des raisons de valoriser.
En Afrique, cette approche quantitative est particulièrement problématique car elle ne prend pas en compte les économies non monétarisées, les systèmes d'entraide communautaire, l'accès aux ressources naturelles communes, ou encore les richesses culturelles et spirituelles. Un agriculteur produisant pour sa subsistance dans un système d'économie vivrière peut être classé comme "pauvre" selon les critères de la Banque mondiale, alors même qu'il jouit d'une sécurité alimentaire, d'un réseau social solide et d'un sentiment de dignité et d'appartenance.
Le regard colonial persistant
La manière dont la pauvreté est représentée et étudiée en Afrique perpétue souvent des tropes coloniaux. Les images de corps émaciés, d'enfants affamés et de villages désolés continuent de dominer les représentations médiatiques et même académiques. Chimamanda Ngozi Adichie a brillamment critiqué ce phénomène dans sa conférence TED "The Danger of a Single Story", expliquant comment "montrer un peuple sous un seul angle, encore et encore, c'est ce qu'ils deviennent".
Cette "pornographie de la pauvreté", pour reprendre l'expression de certains activistes, déshumanise les populations africaines et les réduit à leur supposé dénuement. Elle crée aussi ce que Jean et John Comaroff appellent "Afrique Noire", une Afrique fantasmée, objet permanent d'intervention extérieure. Mais comme le souligne Achille Mbembe "l'Afrique n'a jamais été ce continent d'ombre totale et d'ébène pure que l'Occident n'a cessé de brosser".
La violence épistémique des catégories imposées
L'imposition de catégories comme "pauvre", "sous-développé" ou "vulnérable" constitue ce que Gayatri Spivak appelle une "violence épistémique". En catégorisant les populations africaines selon des critères élaborés ailleurs, on nie leur capacité à se définir elles-mêmes et à articuler leurs propres conceptions du bien-être.
Valentin-Yves Mudimbe, dans The Invention of Africa, démontre comment le discours occidental sur l'Afrique a créé un "ordre de connaissance" qui structure encore aujourd'hui les représentations du continent. Les concepts de pauvreté et de développement s'inscrivent pleinement dans cet ordre colonial du savoir, où l'Occident demeure le sujet connaissant et l'Afrique l'objet connu et déficient.
Des conceptions alternatives du bien-être
Il est crucial de reconnaître que les sociétés africaines possèdent leurs propres philosophies et conceptions du bien-être, de la prospérité et de la bonne vie. Le concept d'Ubuntu en Afrique australe, qui peut se traduire par "je suis parce que nous sommes", propose une vision communautaire du bien-être radicalement différente de l'individualisme économique occidental. Comme l'explique Mogobe Ramose, "Ubuntu affirme que la personne humaine ne peut être humaine que par d'autres personnes".
De même, le concept de Buen Vivir en Amérique latine, élaboré notamment par les penseurs autochtones équatoriens et boliviens, offre un modèle alternatif qui résonne avec certaines philosophies africaines. Il propose une harmonie entre l'humain et la nature, une priorité donnée au collectif sur l'individuel, et une richesse mesurée en termes de liens sociaux plutôt que d'accumulation matérielle.
En Afrique de l'Ouest, les systèmes de parenté à plaisanterie, les associations d'âge et les mécanismes de redistribution traditionnels créent des filets de sécurité sociale qui échappent aux mesures conventionnelles de la pauvreté. L'anthropologue français Jean-François Bayart a montré comment ces "réseaux invisibles" constituent une "économie morale" qui assure la survie et la dignité en dehors des circuits monétaires formels.
Partie 3: Une nouvelle épistémologie pour les jeunes chercheurs africains
Reprendre le pouvoir de nommer
La première étape d'une décolonisation de la question de la pauvreté consiste à reprendre le pouvoir de nommer et de définir. Comme l'écrit Ngũgĩ wa Thiong'o dans Decolonising the Mind, "le processus de colonisation commence par la domination du langage mental de la communauté colonisée". Les chercheurs africains doivent donc s'autoriser à questionner, rejeter ou redéfinir les catégories imposées.
Cela ne signifie pas nier les difficultés économiques réelles auxquelles font face de nombreuses populations africaines. Il s'agit plutôt de les nommer et les analyser depuis des cadres conceptuels ancrés dans les réalités et épistémologies africaines. Paulin Hountondji plaide pour un "savoir endogène" qui parte des problèmes tels qu'ils sont vécus et conceptualisés localement, plutôt que d'importer des problématiques et concepts exogènes.
Centrer les voix et perspectives africaines
Une épistémologie décoloniale de la pauvreté doit impérativement centrer les voix des personnes directement concernées. Trop souvent, la recherche sur la "pauvreté en Afrique" est menée par des chercheurs du Nord, publiée dans des revues du Nord, selon des paradigmes établis au Nord, pour des audiences du Nord. Les Africains deviennent de simples objets d'étude, rarement sujets producteurs de connaissance.
Linda Tuhiwai Smith, dans Decolonizing Methodologies, bien qu'écrivant depuis un contexte maori néo-zélandais, propose des pistes pertinentes pour les chercheurs africains. Elle insiste sur l'importance de méthodologies participatives où les communautés ne sont pas de simples sources de données mais des co-créatrices de savoir. Les méthodologies comme la recherche-action participative, l'ethnographie collaborative ou encore les cercles de dialogue peuvent permettre d'accéder à des compréhensions plus nuancées et ancrées.
Pluraliser les indicateurs et mesures
Il est nécessaire de développer des indicateurs de bien-être qui reflètent les valeurs et priorités des populations africaines elles-mêmes. L'économiste sénégalais Felwine Sarr, dans Afrotopia, appelle à "imaginer de nouveaux modèles de prospérité" qui ne soient pas de pâles copies des trajectoires occidentales. Cela implique de penser des mesures qui intègrent la qualité des liens sociaux, la sécurité alimentaire communautaire, l'accès aux savoirs traditionnels, la préservation des écosystèmes, ou encore la vitalité culturelle.
Certaines initiatives vont déjà dans ce sens. Le Bonheur National Brut développé au Bhoutan, bien qu'asiatique, inspire des réflexions similaires en Afrique. En Namibie, le concept de "living standards measurement" a été adapté pour inclure des dimensions culturelles spécifiques. Ces expériences montrent qu'il est possible de créer des cadres analytiques alternatifs.
Historiciser et contextualiser
Une approche décoloniale exige de toujours historiciser et contextualiser les situations étudiées. On ne peut comprendre les difficultés économiques actuelles sans les relier à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, du néo-colonialisme et des politiques d'ajustement structurel. Comme l'affirme l'historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo, "un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir".
Cette historicisation permet de passer d'une vision de la pauvreté comme état naturel ou culturel de l'Afrique à une compréhension de l'appauvrissement comme processus historique et politique. Elle révèle les responsabilités externes dans la création et le maintien de situations de précarité. Elle permet aussi de retrouver des mémoires de prospérité, d'innovation et de résilience souvent effacées.
Construire des ponts épistémiques
Décoloniser ne signifie pas nécessairement rejeter en bloc tout savoir produit hors d'Afrique. Il s'agit plutôt de construire ce qu'Achille Mbembe appelle une "pensée-monde" qui dialogue avec diverses traditions intellectuelles tout en restant ancrée dans les réalités africaines. Des penseurs comme Frantz Fanon, Aimé Césaire ou Édouard Glissant ont montré comment on peut s'approprier de manière critique des outils conceptuels occidentaux pour les subvertir et les mettre au service de projets émancipateurs.
Cette approche dialogique permet d'éviter le piège d'un essentialisme inverse qui enfermerait l'Afrique dans une altérité radicale. Elle reconnaît l'hybridité des identités et savoirs africains contemporains, fruits de siècles d'échanges, de résistances et de créolisations.
Partie 4: Comment travailler sur la pauvreté quand on est Africain
Assumer sa positionnalité
La première exigence pour un chercheur africain travaillant sur ces questions est d'assumer pleinement sa positionnalité. Qui suis-je par rapport à ceux que j'étudie? Quelle est ma classe sociale, mon niveau d'éducation, mon genre, mon appartenance ethnique ou religieuse? En quoi cela influence-t-il mon regard?
Cette réflexivité, centrale dans les approches féministes et décoloniales, est particulièrement importante en contexte africain où les inégalités entre chercheurs et "populations étudiées" peuvent être considérables. Un doctorant formé à l'étranger enquêtant dans un village rural occupe une position de pouvoir qu'il doit reconnaître et négocier éthiquement.
Questionner le financement et les agendas de recherche
Les jeunes chercheurs africains doivent être conscients que les financements de recherche viennent souvent avec des agendas implicites ou explicites. Les bailleurs internationaux, qu'il s'agisse d'institutions comme la Banque mondiale, d'ONG occidentales ou de fondations philanthropiques, ont leurs propres priorités et cadres conceptuels qui peuvent contraindre la recherche.
Comme le note Mahmood Mamdani dans Scholars in the Marketplace, "la question n'est pas seulement de savoir qui finance la recherche, mais qui définit les questions de recherche". Il est donc crucial de cultiver une autonomie intellectuelle, de chercher des financements qui respectent cette autonomie, et parfois d'accepter de travailler avec moins de moyens pour préserver son indépendance.
Choisir des méthodologies éthiques et appropriées
Les méthodologies de recherche ne sont jamais neutres. Les approches extractivistes où le chercheur arrive, collecte des données et repart sans restitution ni bénéfice pour les communautés reproduisent des schémas coloniaux. À l'inverse, des méthodologies participatives et collaboratives peuvent contribuer à un processus d'empowerment.
Des chercheurs décoloniaux insistent sur l'importance du consentement libre et éclairé, de la co-construction du savoir, et de la restitution des résultats dans des formes accessibles aux communautés. La recherche devient alors un outil potentiel de transformation sociale plutôt qu'un simple exercice académique.
Publier et diffuser différemment
Le système académique mondial privilégie la publication en anglais dans des revues à comité de lecture basées au Nord. Pour les chercheurs africains, cela pose plusieurs problèmes: barrières linguistiques, coûts prohibitifs, pertinence limitée pour les publics locaux, et renforcement de la dépendance intellectuelle.
Il est important de développer des stratégies de publication multiples: publier dans des revues africaines et en langues africaines quand c'est possible, utiliser des formats alternatifs comme les blogs académiques ou les podcasts, participer à des espaces de débat public, et créer des réseaux de chercheurs sud-sud. Des initiatives comme le Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) ou Africa Portal offrent des plateformes importantes pour la diffusion de recherches africaines.
S'engager dans des collectifs
La recherche décoloniale ne peut être un projet solitaire. Elle nécessite des échanges, des débats, des solidarités entre chercheurs africains mais aussi avec des alliés du Nord et d'autres Suds. Des collectifs comme Afrique et développement, les réseaux de l'Afrique francophone de la recherche en éducation, ou encore les mouvements étudiants panafricains créent des espaces précieux de réflexion collective.
Ces collectifs permettent de briser l'isolement, de mutualiser les ressources, de développer des pensées critiques collectives et de créer des contre-pouvoirs face aux institutions qui maintiennent les structures néocoloniales du savoir.
Rester ancré tout en circulant
Enfin, les jeunes chercheurs africains doivent négocier la tension entre ancrage local et circulation globale. Beaucoup sont formés à l'étranger, travaillent dans des langues coloniales, dialoguent avec des littératures internationales. Il ne s'agit pas de rejeter ces formations et circulations, mais de les mettre au service d'un projet intellectuel enraciné.
Comme l'écrit Souleymane Bachir Diagne, "être africain aujourd'hui, c'est nécessairement être dans une situation de traduction et de négociation permanente". Cette position peut être source de richesse créative si elle est assumée consciemment et mise au service d'une pensée véritablement émancipatrice.
Conclusion
Décoloniser la question de la pauvreté en Afrique n'est pas un luxe intellectuel mais une nécessité politique et épistémologique urgente. Tant que nous acceptons passivement les définitions, catégories et mesures imposées de l'extérieur, nous contribuons à perpétuer une forme de domination symbolique et intellectuelle qui légitime les interventions néocoloniales et maintient l'Afrique dans une position subalterne.
Cette décolonisation passe par un triple mouvement: déconstruire les concepts hérités en révélant leurs origines coloniales et leurs effets de pouvoir; valoriser et articuler les épistémologies et conceptions alternatives du bien-être présentes dans les sociétés africaines; et construire de nouveaux cadres analytiques qui centrent les perspectives et aspirations des populations africaines elles-mêmes.
Pour les jeunes chercheurs africains, cet agenda décolonial représente à la fois un défi et une opportunité. Un défi car il exige de rompre avec des habitudes intellectuelles profondément ancrées, de résister aux pressions institutionnelles et aux sirènes du financement conditionnel, et de prendre le risque d'une pensée véritablement autonome. Une opportunité car il ouvre la voie à une créativité intellectuelle renouvelée, à des recherches plus pertinentes et plus utiles pour les communautés africaines, et à la construction d'un savoir véritablement émancipateur.
Comme le rappelle Achille Mbembe, "l'Afrique n'est pas condamnée à répéter l'Europe, elle peut inventer ses propres chemins". Décoloniser le concept de pauvreté fait partie de cette invention nécessaire. Il ne s'agit pas de nier les difficultés matérielles réelles auxquelles font face de nombreuses populations africaines, mais de refuser que ces difficultés soient définies, mesurées et traitées selon des logiques qui reproduisent la domination.
L'enjeu ultime est de passer d'une Afrique objet de discours et d'interventions à une Afrique sujet de sa propre pensée et de son propre devenir. Les questions posées en introduction - qu'est-ce que la pauvreté? comment la regarde-t-on? - ne peuvent recevoir de réponses universelles. Elles doivent être reformulées et réappropriées localement, dans toute leur diversité et complexité. C'est à ce prix que la recherche africaine pourra véritablement contribuer à l'émancipation collective et à la construction d'avenirs désirables pour les populations du continent.
Bibliographie
Amin, Samir. Le développement inégal: Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Paris: Éditions de Minuit, 1973.
Bayart, Jean-François. L'État en Afrique: La politique du ventre. Paris: Fayard, 1989.
Comaroff, Jean, et John Comaroff. Theory from the South: Or, How Euro-America is Evolving Toward Africa. Boulder: Paradigm Publishers, 2012.
Coquery-Vidrovitch, Catherine. Afrique noire: Permanences et ruptures. Paris: L'Harmattan, 1992.
Diagne, Souleymane Bachir. African Art as Philosophy: Senghor, Bergson and the Idea of Negritude. Londres: Seagull Books, 2011.
Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Hountondji, Paulin J. Sur la "philosophie africaine": Critique de l'ethnophilosophie. Paris: François Maspero, 1977.
Ki-Zerbo, Joseph. À quand l'Afrique? Entretien avec René Holenstein. La Tour d'Aigues: Éditions de l'Aube, 2003.
Mamdani, Mahmood. Scholars in the Marketplace: The Dilemmas of Neo-Liberal Reform at Makerere University, 1989-2005. Dakar: CODESRIA, 2007.
Mbembe, Achille. Sortir de la grande nuit: Essai sur l'Afrique décolonisée. Paris: La Découverte, 2010.
Mudimbe, Valentin-Yves. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
Ngũgĩ wa Thiong'o. Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. Londres: James Currey, 1986.
Rahnema, Majid. "Poverty". Dans The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, édité par Wolfgang Sachs, 158-176. Londres: Zed Books, 1992.
Ramose, Mogobe. African Philosophy through Ubuntu. Harare: Mond Books, 1999.
Rist, Gilbert. Le développement: Histoire d'une croyance occidentale. Paris: Presses de Sciences Po, 1996.
Rodney, Walter. How Europe Underdeveloped Africa. Londres: Bogle-L'Ouverture Publications, 1972.
Sarr, Felwine. Afrotopia. Paris: Philippe Rey, 2016.
Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. Londres: Zed Books, 1999.
Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Dans Marxism and the Interpretation of Culture, édité par Cary Nelson et Lawrence Grossberg, 271-313. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
wa Goro, Wangui. "Reclaiming Africa: Confronting the Ideology of Afropessimism". Review of African Political Economy 33, n° 108 (2006): 233-239.